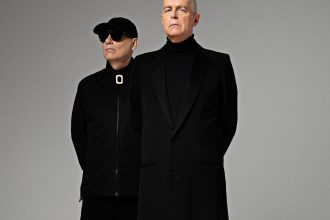Depuis le 13 septembre 2025, Londres abrite un lieu aussi fascinant qu’inattendu : le Centre David Bowie, niché dans les murs du V&A East Storehouse, dans le parc olympique de Queen Elizabeth. Ici, pas de statue figée ni de vitrines poussiéreuses, mais un espace vivant, une “cathédrale de la créativité” comme l’a décrit la presse, où 90 000 objets – costumes, manuscrits, instruments, photos, croquis – racontent l’histoire d’un artiste qui a passé sa vie à se réinventer, à se désintégrer, à renaître.
Un musée qui respire
Contrairement aux expositions posthumes souvent statiques, le Centre Bowie mise sur le mouvement. Les expositions thématiques tournent tous les six mois, révélant tour à tour des trésors cachés : la clé de l’appartement berlinois partagé avec Iggy Pop, les notes manuscrites de “Heroes”, les croquis de la pochette de “Space Oddity”, ou encore les post-it épars d’un projet inachevé, “The Spectator”, une comédie musicale inspirée du Londres du XVIIIe siècle, abandonnée à sa mort en 2016. “Nous voulons que les visiteurs soient inspirés par Bowie, qu’ils poursuivent leur propre créativité”, explique Madeleine Haddon, commissaire de l’exposition. Un vœu pieux, quand on sait que Bowie lui-même détestait les musées, ces “cimetières de la culture”.
L’archiviste et le magicien Parmi les pièces les plus poignantes, on trouve des objets qui révèlent l’homme derrière le mythe : des listes de livres à lire, de films à voir, de musées à visiter – une boulimie culturelle qui explique peut-être son génie protéiforme. Et puis, il y a les costumes, bien sûr : le justaucorps de Ziggy Stardust, la veste Union Jack conçue avec Alexander McQueen, ou encore les tenues androgynes des années 70, qui semblent presque trop fragiles pour être exposées. Comme si Bowie, même mort, continuait à jouer avec les limites entre art et artifices.
Un lieu pour les fans… et les universitaires Le Centre n’est pas qu’un musée, c’est aussi un espace d’étude. Les chercheurs peuvent y consulter des archives inédites, des enregistrements rares, des correspondances. “C’est un lieu où l’on peut comprendre comment Bowie a transformé la pop en art, et l’art en pop”, résume un conservateur. Une ironie de l’histoire : celui qui a passé sa vie à fuir les étiquettes se retrouve aujourd’hui classé, archivé, étudié – mais avec une élégance qui lui aurait peut-être plu.
Bowie à Berlin : le documentaire qui révèle l’homme derrière le masque
Si le Centre Bowie célèbre l’artiste, le documentaire “Bowie in Berlin”, produit par la BBC et attendu pour l’automne 2026, promet de révéler l’homme – ou du moins, une facette méconnue de lui. Réalisé par Francis Whately (déjà aux commandes de “David Bowie: The Last Five Years”), le film plonge dans les années 1976-1978, lorsque Bowie, rongé par la cocaïne et écrasé par la célébrité, fuit Los Angeles pour se réfugier à Berlin-Ouest, alors en pleine Guerre froide.
Berlin, ou comment disparaître pour renaître À l’époque, Bowie n’est plus Ziggy Stardust, mais un fantôme. Il s’installe dans un appartement modeste du quartier de Schöneberg, partage son quotidien avec Iggy Pop, et se met à composer “Low”, “Heroes” et “Lodger” – la fameuse “Trilogie berlinoise”, aujourd’hui considérée comme l’un des sommets de sa carrière. “Il est arrivé à Berlin brisé, et il en est reparti transformé”, raconte l’une des quatre femmes interviewées pour le documentaire : Clare Shenstone, Romy Haag, Sarah-Rena Hine et Sydne Rome, ses muses et confidentes de l’époque.
Un Bowie vulnérable, loin des paillettes Le film s’appuie sur des archives inédites et des témoignages intimes pour dessiner le portrait d’un Bowie “timide, introspectif, vulnérable”, loin de l’image du dandy extraverti. “Il détestait la célébrité, il avait besoin de se cacher pour créer”, explique une proche. À Berlin, il se fond dans la foule, fréquente les clubs underground, collabore avec Brian Eno, et puise dans l’énergie sombre de la ville divisée pour inventer une nouvelle forme de musique – froide, expérimentale, profondément humaine.
La trilogie berlinoise : un héritage toujours vivant
“Low”, “Heroes” et “Lodger” n’ont pas seulement marqué l’histoire du rock : ils ont redéfini ce que pouvait être la pop. “Heroes”, enregistré aux studios Hansa près du Mur, est devenu un hymne universel, tandis que “Low” a inspiré des générations d’artistes, de Radiohead à Arcade Fire. Le documentaire promet de revenir sur la genèse de ces albums, mais aussi sur les collaborations secrètes, les nuits blanches, et les moments de doute qui ont précédé leur création.
Pourquoi ce film arrive-t-il maintenant ? Cinquante ans après l’arrivée de Bowie à Berlin, la BBC choisit de célébrer cette période charnière avec un film qui ne se contente pas de la mythologie. “Nous voulons montrer Bowie tel qu’il était : un artiste en quête de vérité, même quand celle-ci le terrassait”, explique Jonathan Rothery, responsable des documentaires musicaux à la BBC. Une approche qui tranche avec les hommages lénifiants, et qui rappelle que le génie, souvent, naît du chaos.
Deux facettes d’un même homme : le génie et le fantôme
Entre le Centre Bowie, qui immortalise l’artiste en le rendant accessible, et “Bowie in Berlin”, qui explore ses zones d’ombre, se dessine le portrait d’un homme aussi insaisissable que prolifique. À Londres, on célèbre le showman, le créateur de personnages, l’icône intemporelle. À Berlin – ou du moins dans le récit qu’en fait la BBC –, on découvre l’homme, fragile, en quête de sens, prêt à tout sacrifier pour se réinventer.
Une question persiste : Bowie aurait-il aimé tout cela ? Probablement pas. Lui qui a passé sa vie à brouiller les pistes, à jouer avec les identités, à refuser d’être figé, se retrouverait sans doute mal à l’aise dans un musée, même conçu à son image. Pourtant, il y a quelque chose de profondément bowien dans ces deux projets : une volonté de transgresser les limites, de mélanger les genres, de transformer l’héritage en quelque chose de vivant.
Alors, si vous passez par Londres, faites un tour au Centre Bowie. Et si vous attendez le documentaire, préparez-vous à découvrir un Berlin des années 70 où un homme, perdu et génial, a trouvé le moyen de se sauver en créant de la beauté là où il n’y avait que des ruines.
“Le rock, c’est du théâtre”, disait Bowie. Aujourd’hui, le rideau se lève sur une nouvelle scène – et le spectacle, décidément, n’est pas près de s’arrêter.
Et vous, plutôt musée ou documentaire ?
David Bowie Centre – V&A East Storehouse, Parkes Street, Queen Elizabeth Olympic Park, Hackney Wick, Londres, E20 3AX – Prix libre (mais billet pour le musée obligatoire)